 1842- 47: angle du
quai et rue de la Barre.
1842- 47: angle du
quai et rue de la Barre.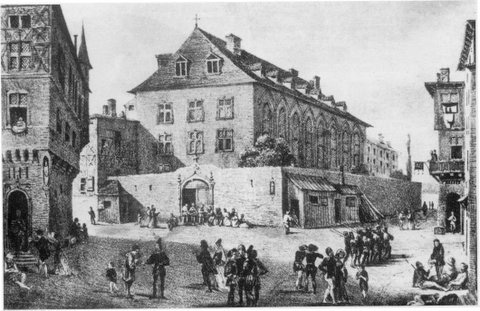 ps de Rabelais (l'actuelle Chapelle occupe son
emplacement) et Hôtel-Dieu au XVIIe)
ps de Rabelais (l'actuelle Chapelle occupe son
emplacement) et Hôtel-Dieu au XVIIe)
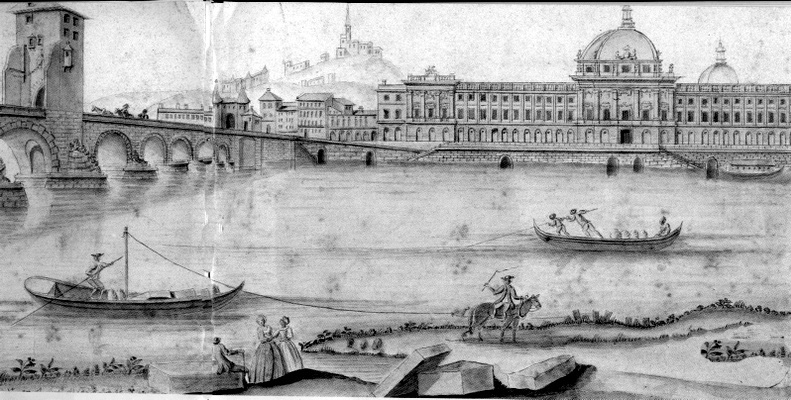
ci-dessous
:Hôtel-Dieu au
tem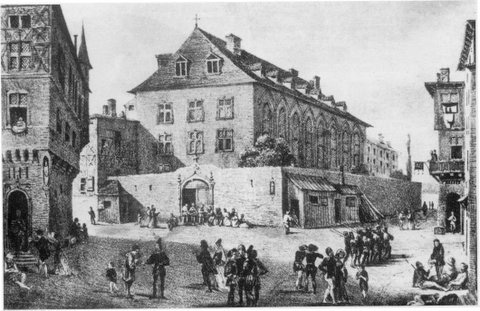 ps de Rabelais (l'actuelle Chapelle occupe son
emplacement) et Hôtel-Dieu au XVIIe)
ps de Rabelais (l'actuelle Chapelle occupe son
emplacement) et Hôtel-Dieu au XVIIe)
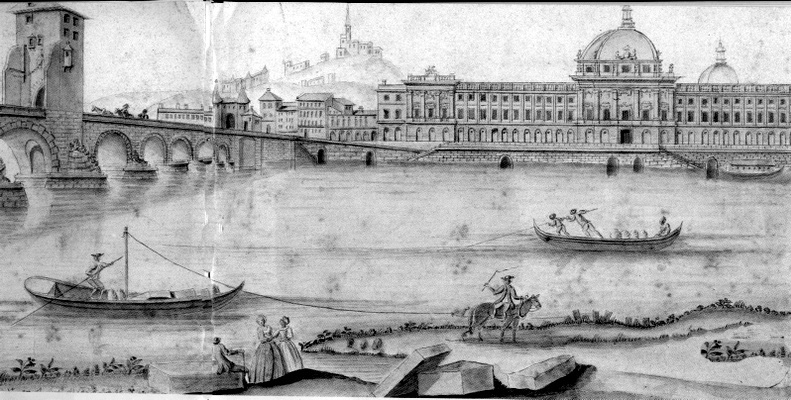
Lyon s'honore de treize
siècles d'activité
hospitalière : c'est en 542 que le roi Childebert et la
reine
Ultrogothe ont
fondé le
premier hôptal lyonnais à l'instigation de Saint-Sacerdos,
évêque de Lyon. Alors situé sur la rive
droite de la
Saône, l'hôpital n'a été
déplacé
que six siècles plus tard sur la rive
droite du
Rhône, à l'emplacement actuel
de l'Hôtel-Dieu. En effet, Lyon
, important noeud de communications
entre le Nord et le Sud, l'Ouest et les plaines du
Dauphiné, était handicapé par
l'obstacle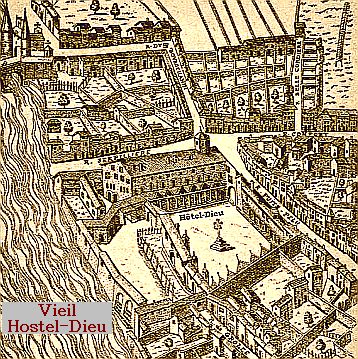 redoutable du Rhône,
fleuve de cinq cents
mètres de large, aux
crues dévastatrices. Le franchissement par bateaux ou bacs
à câble (trails) était dangereux. Un
pont sur
le Rhône à Lyon était d'une grande
nécessité. En 1177, des
constructeurs de pont,
"les
frères Pontifes" , avaient, en Avignon,
établi
le premier pont sur le Rhône : le fameux
pont Benezet. Six ans
plus tard, ils viennent à Lyon avec le
projet
d'y construire un pont de bois :
ce premier pont
du
Rhône
du Xlle siècle se situait en regard du centre de la
façade de l'Hôtel-Dieu. La
rue aboutissant
à ce pont, du côté de la
presqu'ile,
s'appelait la rue
Serpillière.,
passant à
l'emplacement actuel du réfectoire et du
dôme.
L'abbaye d'Ainay, propriétaire des terrains de la rive
droite,
exigeait un droit de péage. Ce
pont de bois fragile a
été transitoire.
Le
passage des troupes de Philippe Auguste et de Richard Coeur de Lion, en
route pour la troisième croisade, l'ont
effondré en 1190. Le pont a
été alors
reconstruit plus en aval sous la forme bien connuede l'histoire de
Lyon. Ses
arches de pierres étaient amarrées dans
le lit du
fleuve par des
piliers de
chêne pointés avec des bardeaux de fer. Sur
ce pont
va transiter pratiquement tout le trafic
de
l'Europe. Les voyageurs sont des gens de toute
condition physique dont certains à bout de
résistance
nécessitaient un hébergement. Dans leur
tradition, les
frères Pontifes construisaient toujours à
l'extrémité des ponts, d'abord une chapelle,
puis un
bâtiment d'hébergement. Ils y
accueillaient tous
les passants malades. Il en fut ainsi pour le pont
du Rhône: le
personnel comportait simplement deux religieux et trois
domestiques. Les frères Pontifes vont se
débarrasser
très vite de ces bâtiments et de leur entretien,
en les
confiant aux religieux d'Hautecombe. Ceux-ci le 29 Août 1
redoutable du Rhône,
fleuve de cinq cents
mètres de large, aux
crues dévastatrices. Le franchissement par bateaux ou bacs
à câble (trails) était dangereux. Un
pont sur
le Rhône à Lyon était d'une grande
nécessité. En 1177, des
constructeurs de pont,
"les
frères Pontifes" , avaient, en Avignon,
établi
le premier pont sur le Rhône : le fameux
pont Benezet. Six ans
plus tard, ils viennent à Lyon avec le
projet
d'y construire un pont de bois :
ce premier pont
du
Rhône
du Xlle siècle se situait en regard du centre de la
façade de l'Hôtel-Dieu. La
rue aboutissant
à ce pont, du côté de la
presqu'ile,
s'appelait la rue
Serpillière.,
passant à
l'emplacement actuel du réfectoire et du
dôme.
L'abbaye d'Ainay, propriétaire des terrains de la rive
droite,
exigeait un droit de péage. Ce
pont de bois fragile a
été transitoire.
Le
passage des troupes de Philippe Auguste et de Richard Coeur de Lion, en
route pour la troisième croisade, l'ont
effondré en 1190. Le pont a
été alors
reconstruit plus en aval sous la forme bien connuede l'histoire de
Lyon. Ses
arches de pierres étaient amarrées dans
le lit du
fleuve par des
piliers de
chêne pointés avec des bardeaux de fer. Sur
ce pont
va transiter pratiquement tout le trafic
de
l'Europe. Les voyageurs sont des gens de toute
condition physique dont certains à bout de
résistance
nécessitaient un hébergement. Dans leur
tradition, les
frères Pontifes construisaient toujours à
l'extrémité des ponts, d'abord une chapelle,
puis un
bâtiment d'hébergement. Ils y
accueillaient tous
les passants malades. Il en fut ainsi pour le pont
du Rhône: le
personnel comportait simplement deux religieux et trois
domestiques. Les frères Pontifes vont se
débarrasser
très vite de ces bâtiments et de leur entretien,
en les
confiant aux religieux d'Hautecombe. Ceux-ci le 29 Août 1 315
le
cèdent aux religieux de Chassagne. En 1334 pour la
première fois, il est fait mention de soins dans cette
structure
d'hébergement. Les
religieux de Chassagne ne résolvent pas mieux les
problèmes financiers et en 1478, ils vendent ce
bâtiment aux consuls de la ville de Lyon (qui depuis
1312 géraient la ville au nom du
Roi).
315
le
cèdent aux religieux de Chassagne. En 1334 pour la
première fois, il est fait mention de soins dans cette
structure
d'hébergement. Les
religieux de Chassagne ne résolvent pas mieux les
problèmes financiers et en 1478, ils vendent ce
bâtiment aux consuls de la ville de Lyon (qui depuis
1312 géraient la ville au nom du
Roi).
L'évolution de l' Hôtel-Dieu se fait alors en trois étapes:
-1-
En
1529 intervient un désordre civil majeur, la grande
Rebeyne, due à la famine
consécutive aux
mauvaises
récoltes. Les rues sont envahies par des
mendiants et des familles venues des campagnes
environnantes. François 1er décrète
l'institution d'une Aumônerie Générale
destinée à accueillir et à
héberger les pauvres. C'est
la création de
l'Hôpital de
la Charité
implanté à deux cents
mètres
de l'Hôtel Dieu. Cet
hôpital décharge l'Hôtel-Dieu
de certaines de ses obligations,
notamment en accueillant les enfants abandonné. En
contrepartie, cette aide implique la
nécessité de partager le profit des
quêtes.
L'indication portée à l'entrée de
l'Hôtel-Dieu proche de la Chapelle "Hôpital
Général" n'est pas neutre. En effet,
c'est
cette
dénomination qui permettait à
l'Hôtel-Dieu de
revendiquer, à part égale avec la
Charité, une
partie des ressources provenant des quêtes.
![]()
 -3-
Des circonstances plus favorables sont liées à
l'agrandissement des
propriétés de l'Hôtel-Dieu. Leur domaine devient important
à la suite du don des territoires de la Part-Dieu, par Mme
veuve Mazenod, très affectée par un accident
qu'elle avait provoqué sur le pont du Rhône. Il
s'y ajoute les très importants terrains de la Tête
d'Or. Ce n'était qu'une richesse
potentielle car, en raison du régime irrégulier
du Rhône, cette rive gauche ne présentait
à l'époque aucun
intérêt
économique. Comme il faut absolument de l'argent,
on fait appel
au roi qui accorde des taxes
supplémentaires. On taxe même
les comédiens : leur première
représentation à leur arrivée
à Lyon est donnée au
bénéfice des pauvres. Ces ressources
permettent d'agrandir les bâtiments. On construit l'ensemble
dit du "petit
dôme" hospitalier, le premier
de ce genre construit en France, copie d'un
hôpital de Milan. Il est encadré de quatre ailes,
dites des "quatre rangs",
centrées sur le
dôme avec au milieu un autel. On peut alors
détruire le premier bâtiment d'hospitalisation
datant du XVle
siècle, devenu inutile, et à son emplacement
construire la Chapelle avec la belle façade Louis XIII. La
porte principale avec la mention "Hôpital
Général " construite en 1706 par Delamonce vient
achever la construction.
-3-
Des circonstances plus favorables sont liées à
l'agrandissement des
propriétés de l'Hôtel-Dieu. Leur domaine devient important
à la suite du don des territoires de la Part-Dieu, par Mme
veuve Mazenod, très affectée par un accident
qu'elle avait provoqué sur le pont du Rhône. Il
s'y ajoute les très importants terrains de la Tête
d'Or. Ce n'était qu'une richesse
potentielle car, en raison du régime irrégulier
du Rhône, cette rive gauche ne présentait
à l'époque aucun
intérêt
économique. Comme il faut absolument de l'argent,
on fait appel
au roi qui accorde des taxes
supplémentaires. On taxe même
les comédiens : leur première
représentation à leur arrivée
à Lyon est donnée au
bénéfice des pauvres. Ces ressources
permettent d'agrandir les bâtiments. On construit l'ensemble
dit du "petit
dôme" hospitalier, le premier
de ce genre construit en France, copie d'un
hôpital de Milan. Il est encadré de quatre ailes,
dites des "quatre rangs",
centrées sur le
dôme avec au milieu un autel. On peut alors
détruire le premier bâtiment d'hospitalisation
datant du XVle
siècle, devenu inutile, et à son emplacement
construire la Chapelle avec la belle façade Louis XIII. La
porte principale avec la mention "Hôpital
Général " construite en 1706 par Delamonce vient
achever la construction.
Renommée
prestigieuse et pourtant faillite
inéluctable (XVIIIe siècle)
![]() La réputation de l'Hôtel-Dieu se répand
et les malades affluent : plus de cent mille
patients soignés
par an.
Il faut toujours plus de place. Par chance, les finances
s'améliorent. En effet, les terrains de la rive gauche sont
peu à peu aménagés et deviennent une
zone de récréation. On y plante des petites
baraques où l'on vend divers produits alimentaires et les
Hospices touchent une redevance sur chaque transaction. Surtout, ils
sont propriétaires des bacs à trail qui,
en amont du
pont de
pierre, assurent la traversée du Rhône. Chaque
passage apporte des ressources. On décide alors d'agrandir
l'Hôpital. Pour construire, il faut d'abord
déblayer le
terrain. En effet, les
bâtiments étaient entourés de
toute une
série de
petites maisons privées. La rue Serpillière
coupait
complètement le terrain nécessaire
à
l'extension. On l'a donc
récupéré et
acheté chacune
des parcelles voisines. Les recteurs envisagent la
construction
d'un long bâtiment tout au long du fleuve. Mais,en
même
temps la municipalité a aussi le projet de
restructurer la rive droite du Rhône. Un quai est
décidé. Comment coordonner les deux
démarches? La
municipalité indique :"Il
faudrait que ce soit un peu noble, que cela ait de l'allure, que cela
soit représentatif de la puissance de Lyan, donc il faut de
la pierre de taille et un bon architecte... ". On
s'adresse à
La réputation de l'Hôtel-Dieu se répand
et les malades affluent : plus de cent mille
patients soignés
par an.
Il faut toujours plus de place. Par chance, les finances
s'améliorent. En effet, les terrains de la rive gauche sont
peu à peu aménagés et deviennent une
zone de récréation. On y plante des petites
baraques où l'on vend divers produits alimentaires et les
Hospices touchent une redevance sur chaque transaction. Surtout, ils
sont propriétaires des bacs à trail qui,
en amont du
pont de
pierre, assurent la traversée du Rhône. Chaque
passage apporte des ressources. On décide alors d'agrandir
l'Hôpital. Pour construire, il faut d'abord
déblayer le
terrain. En effet, les
bâtiments étaient entourés de
toute une
série de
petites maisons privées. La rue Serpillière
coupait
complètement le terrain nécessaire
à
l'extension. On l'a donc
récupéré et
acheté chacune
des parcelles voisines. Les recteurs envisagent la
construction
d'un long bâtiment tout au long du fleuve. Mais,en
même
temps la municipalité a aussi le projet de
restructurer la rive droite du Rhône. Un quai est
décidé. Comment coordonner les deux
démarches? La
municipalité indique :"Il
faudrait que ce soit un peu noble, que cela ait de l'allure, que cela
soit représentatif de la puissance de Lyan, donc il faut de
la pierre de taille et un bon architecte... ". On
s'adresse à 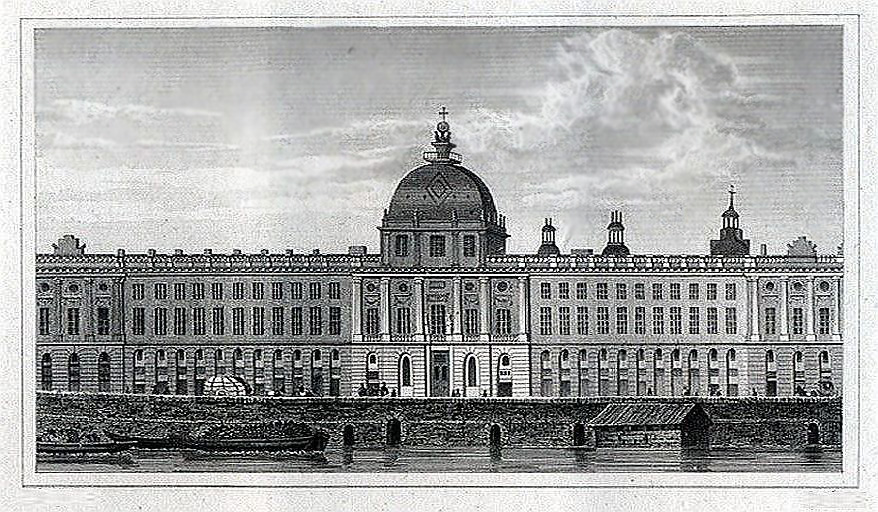 Soufflot, qui habitait alors
à
Lyon : il propose un projet majestueux et
équilibré, préfigurant la
façace
actuelle sur le Rhône. Le corps central avec son
grand dôme est
complété de chaque côté par
des bâtiments en
légère angulation vers l'arrière, ce
qui allège l'ensemble. Fait
remarquable, cette harmonie
a résisté au fractionnement des
travaux étalés sur deux
siècles ainsi
qu'au changement
d'architecte. En effet, après deux ans,
Soufflot part
à Paris et confie la construction finale
à un de
ses collaborateurs, Loyer, qui décide de
retoucher les plans du dôme.
Celui-ci n'est terminé que huit à douze
ans
après le reste des bâtiments. Le dôme
était justifié par des raisons
d'hygiène ;
non seulement il donne beaucoup d'allure
à l'ensemble du bâtiment, mais aussi il assurer la
ventilation des salles de malade pour les débarasser des
"miasmes". En 1761, la moitié de
la façade est construite ce qui complète les
capacités d'accueil des quatre rangs "(mille quatre cents
malades hospitalisés et trois mille enfants
accueillis). À partir de cette date,
l'Hôtel-Dieu va connaitre trente années
magnifiques. On
réalise à l'intérieur des travaux que
l'on qualifierait aujourd'hui d'humanisation : on substitue
aux lits de bois,
à trois voire quatre places, des couchettes
métalliques individuelles. Pour cela on organise des
souscriptions : ainsi en 1787 on recueille cent cinquante six mille
livres.
Soufflot, qui habitait alors
à
Lyon : il propose un projet majestueux et
équilibré, préfigurant la
façace
actuelle sur le Rhône. Le corps central avec son
grand dôme est
complété de chaque côté par
des bâtiments en
légère angulation vers l'arrière, ce
qui allège l'ensemble. Fait
remarquable, cette harmonie
a résisté au fractionnement des
travaux étalés sur deux
siècles ainsi
qu'au changement
d'architecte. En effet, après deux ans,
Soufflot part
à Paris et confie la construction finale
à un de
ses collaborateurs, Loyer, qui décide de
retoucher les plans du dôme.
Celui-ci n'est terminé que huit à douze
ans
après le reste des bâtiments. Le dôme
était justifié par des raisons
d'hygiène ;
non seulement il donne beaucoup d'allure
à l'ensemble du bâtiment, mais aussi il assurer la
ventilation des salles de malade pour les débarasser des
"miasmes". En 1761, la moitié de
la façade est construite ce qui complète les
capacités d'accueil des quatre rangs "(mille quatre cents
malades hospitalisés et trois mille enfants
accueillis). À partir de cette date,
l'Hôtel-Dieu va connaitre trente années
magnifiques. On
réalise à l'intérieur des travaux que
l'on qualifierait aujourd'hui d'humanisation : on substitue
aux lits de bois,
à trois voire quatre places, des couchettes
métalliques individuelles. Pour cela on organise des
souscriptions : ainsi en 1787 on recueille cent cinquante six mille
livres.
![]() On recrute des praticiens par des
concours hospitaliers qui ont fait la qualité de la
médecine hospitalière lyonnaise. Le premier
chirurgien-major
fut Marc-Antoine Petit, en 1788. Ce n'est qu'en
1811 que l'on institue un concours de
médecins des
hôpitaux. Ce recrutement est novateur et
efficace : en effet,
chaque nouveau chirurgien-major est recruté
d'abord comme stagiaire, avec nécessité d'un
séjour de deux ans à Paris pour
compléter sa formation. Lorsque le chirurgien titulaire
a terminé son activité, on lui demande
de
rester pendant deux ou trois ans pour faire
bénéficier son successeur de son
expérience. Surtout dans cet
hôpital fonctionne grâve à des soeurs
hospitalières lyonnaises.
Ces soeurs n'ont pas de hiérarchie ecclésiastique
directe, ne dépendant que de la seule
autorité civile.
Elles ont une formation de qualité,
d'où leur efficacité dans cette
époque
où les soins primaires étaient si importants.
Leur présence ajoute aussi une dimension spirituelle
appréciée. Des innovations
améliorent leur mission : les soeurs
hospitalières,
depuis 1719, peuvent être détachées
dans une activité extérieure d'hospitalisation
à domicile, notamment pour le soin aux femmes en couches;
des
soeurs pharmaciennes vendent au public
extérieur des
médicaments. Un malade par lit, des
bâtiments salubres, des infirmières
compétentes,
des médecins et chirurgiens recrutés sur leur
valeur, améliorent donc l'efficacité des
soins. La
mortalité à l'Hôtel-Dieu de Lyon
était de 6 % au lieu de 25 % à
l'Hôtel-Dieu de Paris. Cela se sait en France :
dès qu'un visiteur célèbre
s'intéresse à la
médecine, on lui conseille d'aller à Lyon (Joseph
Il qui parlait du fameux "temple élevé
à la fièvre ", le futur tsar Paul 1er,
le
Général Lafayette, etc.).
Louis XVI diligente même une enquête de
l'Académie des sciences pour savoir comment il fallait
construire un hôpital. Les conclusions sont que
l'Hôtel-Dieu de Lyon était le
plus bel
hôpital du royaume.
On recrute des praticiens par des
concours hospitaliers qui ont fait la qualité de la
médecine hospitalière lyonnaise. Le premier
chirurgien-major
fut Marc-Antoine Petit, en 1788. Ce n'est qu'en
1811 que l'on institue un concours de
médecins des
hôpitaux. Ce recrutement est novateur et
efficace : en effet,
chaque nouveau chirurgien-major est recruté
d'abord comme stagiaire, avec nécessité d'un
séjour de deux ans à Paris pour
compléter sa formation. Lorsque le chirurgien titulaire
a terminé son activité, on lui demande
de
rester pendant deux ou trois ans pour faire
bénéficier son successeur de son
expérience. Surtout dans cet
hôpital fonctionne grâve à des soeurs
hospitalières lyonnaises.
Ces soeurs n'ont pas de hiérarchie ecclésiastique
directe, ne dépendant que de la seule
autorité civile.
Elles ont une formation de qualité,
d'où leur efficacité dans cette
époque
où les soins primaires étaient si importants.
Leur présence ajoute aussi une dimension spirituelle
appréciée. Des innovations
améliorent leur mission : les soeurs
hospitalières,
depuis 1719, peuvent être détachées
dans une activité extérieure d'hospitalisation
à domicile, notamment pour le soin aux femmes en couches;
des
soeurs pharmaciennes vendent au public
extérieur des
médicaments. Un malade par lit, des
bâtiments salubres, des infirmières
compétentes,
des médecins et chirurgiens recrutés sur leur
valeur, améliorent donc l'efficacité des
soins. La
mortalité à l'Hôtel-Dieu de Lyon
était de 6 % au lieu de 25 % à
l'Hôtel-Dieu de Paris. Cela se sait en France :
dès qu'un visiteur célèbre
s'intéresse à la
médecine, on lui conseille d'aller à Lyon (Joseph
Il qui parlait du fameux "temple élevé
à la fièvre ", le futur tsar Paul 1er,
le
Général Lafayette, etc.).
Louis XVI diligente même une enquête de
l'Académie des sciences pour savoir comment il fallait
construire un hôpital. Les conclusions sont que
l'Hôtel-Dieu de Lyon était le
plus bel
hôpital du royaume.
Préfiguration
de C.H.U. (XIXe
siècle)
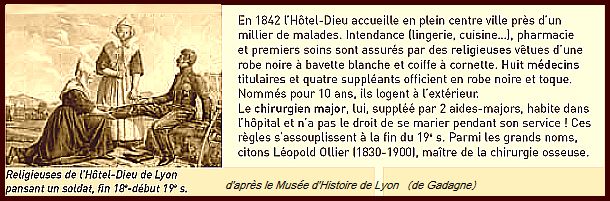 La
situation se redresse au début du siècle,
grâce aux travaux d'urbanisme des préfets. En
effet, la rive gauche du Rhône est devenue constructible et
ses terrains marécageux, enfin
asséchés, se couvrent d'immeubles de
qualité, source de profits. Les dons continuent à
affluer, non seulement en maisons, terrains et autres, mais aussi en
argent liquide. On peut enfin terminer l'Hôtel-Dieu
La
situation se redresse au début du siècle,
grâce aux travaux d'urbanisme des préfets. En
effet, la rive gauche du Rhône est devenue constructible et
ses terrains marécageux, enfin
asséchés, se couvrent d'immeubles de
qualité, source de profits. Les dons continuent à
affluer, non seulement en maisons, terrains et autres, mais aussi en
argent liquide. On peut enfin terminer l'Hôtel-Dieu
1821-24 : aile nord de la façade,
1825 -29 : cour des cuisines,
1838 - 41: aile sud de la façade,
1840 : passage de l'Hôtel-Dieu,
1842- 47: angle du quai et rue de la Barre.
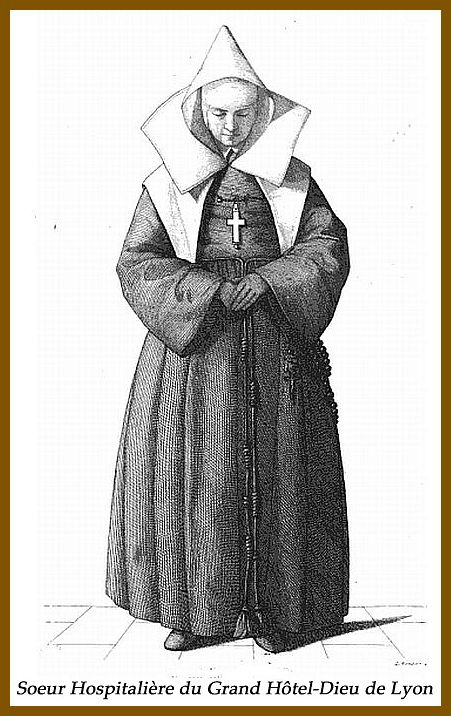 urent données par
l'administrateur Godinot,
ancêtre d'un de nos anciens
collègues. Les locaux de
la rue de la Barre sont consacrés, à partir de
1881,
à l'enseignement. C'est tout d'abord l'école
secondaire
puis l'école préparatoire.
L'amphithéâtre
est installé sous le dôme Pascalon. Cette
école de
médecine, implantée dans l'hôpital, est
gérée par l'administration
hospitalière et
financée par les H.C.L ; c'est donc bien un C.H.U avant la
lettre. Cet enseignement persiste sous cette forme jusqu'en 1877, date
à laquelle la faculté de médecine de
Lyon est
créée, mais en 1883 elle quitte
l'Hôtel-Dieu pour
gagner les locaux universitaires de la rive gauche du Rhône
nouvellement construits.
urent données par
l'administrateur Godinot,
ancêtre d'un de nos anciens
collègues. Les locaux de
la rue de la Barre sont consacrés, à partir de
1881,
à l'enseignement. C'est tout d'abord l'école
secondaire
puis l'école préparatoire.
L'amphithéâtre
est installé sous le dôme Pascalon. Cette
école de
médecine, implantée dans l'hôpital, est
gérée par l'administration
hospitalière et
financée par les H.C.L ; c'est donc bien un C.H.U avant la
lettre. Cet enseignement persiste sous cette forme jusqu'en 1877, date
à laquelle la faculté de médecine de
Lyon est
créée, mais en 1883 elle quitte
l'Hôtel-Dieu pour
gagner les locaux universitaires de la rive gauche du Rhône
nouvellement construits. Dans cet Hôtel-Dieu dédié à l'enseignement et aux soins travaillaient des médecins de grande qualité. Les chirurgiens étaient notamment des opérateurs remarquables : Gensoul extirpe en un quart d'heure une énorme tumeur du maxillaire supérieur sans anesthésie. Amédée Bonnet a le mérite d'introduire l'anesthésie quelques mois seulement après l'expérience de Morton, à Boston. Ces deux hommes sont non seulement des professionnels de qualité mais aussi des hommes de coeur et de responsabilité. Ainsi, en 1831, Gensoul s'oppose à l'arrivée des insurgés de la première révolte des canuts qui veulent massacrer des soldats blessés. Trois ans plus tard, Amédée Bonnet soigne, dans l'église Saint Bonaventure, les insurgés blessés pour les protéger contre la troupe qui les poursuit. Les résultats chirurgicaux s'améliorent grâce à Antonin Poncet qui introduit l'asepsie et l'antisepsie. L'Hôtel-Dieu devient un foyer de médecine expérimentale. Raphaèl Lèpine y réalise ses travaux sur le pancréas endocrine. Olliera est le premier thérapeute à appliquer les principes de la démarche préconisée par Claude Bernard (observation clinique, expérimentation animale, application thérapeutique). Tous comprennent l'importance pour le traitement des tuberculoses osseuses de ses travaux sur l'ostéogenèse périostée. C'est aussi l'époque où quelque deux mois seulement après la découverte de Rôntgen, Étienne Destot, en bricoleur de génie, fait ses premières radiographies et allie sa technicité à la démarche expérimentale et chirurgicale d'Ollier. Hélas, en 1887, quelqu'un écrit au directeur-administrateur de l'Hôtel-Dieu pour lui dire que cet hôpital est bien encombrant pourrait faire place à quelquechose de mieux . Le drame est que Jules Courmont, personnalité éminente, s'empare de cette idée : il considère que cette bâtisse est en mauvais état et antihygiénique, et que pour la réparer les dépenses dépasseront celles d'un bâtiment neuf. En 1905, Édouard Herriot devient maire. Il est très proche de Jules Courmont et, l'anticléricalisme aidant, tout se ligue pour essayer de faire disparaître l'Hôtel-Dieu. C'est finalement, en 1934, l'inscription à l'inventaire des monuments historiques qui permet la conservation de l'Hôtel -Dieu.
Le passé récent et la fin de l'Hôpital du pont du Rhône (XXe-XXIe siècle)
Mais l'Hôtel-Dieu a été aussi un lieu de culture et de visites. La culture et la documentation médicales ont bénéficié de la bibliothèque de l'internat. D'autre part, le musée, créé en 1935 sous le petit dôme, comprend trois salles provenant de l'Hôpital de la Charité (disparu) : bureau de réunion des recteurs, pharmacie du XVIIe, salle d'archives datant du XVIIIe aux bois magnifiquement sculptés. Ce musée a subi des transformations et extensions, et ses collections, pots de faïence ou instruments médicaux, ont suscité l'intérêt de nombreux visiteurs.
Et pourtant maintenant la fin de cet Hôpital est définitivement programmée. L'Hôpital "du pont du Rhône" ou "Grand Hôtel-Dieu" est ainsi condamné sans appel. Les nécessités économiques d'aujourd'hui, bien plus redoutables que celles du passé, ont finalement pris le dessus. Malgré son histoire prestigieuse, l'Hôtel-Dieu de Lyon sera prochainement démédicalisé et privatisé.